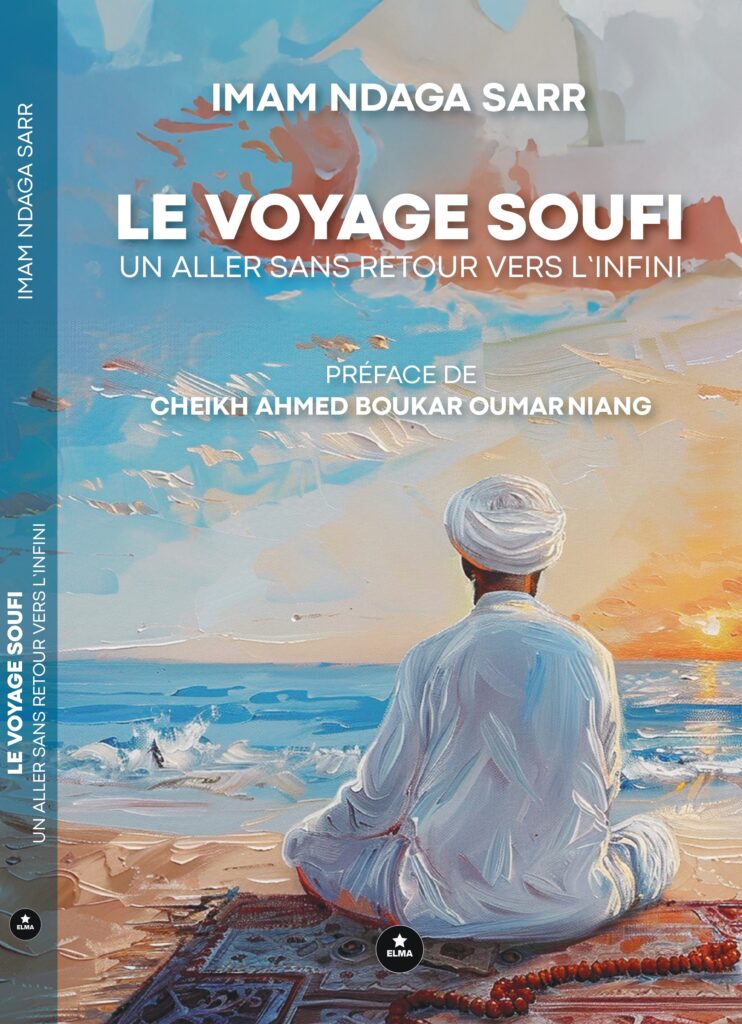Le temps, dans sa mesure et son organisation, a toujours été une préoccupation centrale des civilisations humaines, reflétant leur quête d’ordre et de compréhension du cosmos. Les calendriers lunaire et solaire, bien que fondamentalement différents dans leur approche, témoignent d’un besoin universel de synchroniser l’activité humaine avec les cycles naturels, tout en répondant à des impératifs culturels, religieux et pratiques. Ces deux systèmes incarnent une tension entre la fluidité des cycles lunaires et la régularité apparente des cycles solaires, offrant chacun une vision unique du rapport au temps.
Le calendrier lunaire, basé sur les cycles de la lune, trouve ses origines dans les sociétés anciennes où l’observation directe des phases lunaires était essentielle pour structurer la vie religieuse et sociale. Chaque lunaison, d’une durée d’environ 29,53 jours, définit un mois lunaire, donnant à l’année lunaire une durée totale de 354 jours, soit 11 jours de moins que l’année solaire. Dans le Coran, ce calendrier est consacré comme une mesure divine du temps, particulièrement adaptée aux pratiques religieuses. Le verset : “Ils t’interrogent au sujet des nouveaux croissants. Dis : « Ils servent aux gens pour mesurer le temps, et pour le pèlerinage. »” (Sourate Al-Baqara, 2:189) souligne le rôle central des cycles lunaires dans l’organisation des rites islamiques, tels que le Ramadan et le Hajj. En abrogeant la pratique préislamique de l’intercalation (nasi’), l’islam a ancré définitivement le calendrier lunaire dans sa pureté originelle, dissociant le temps liturgique des saisons terrestres.
En revanche, le calendrier solaire repose sur la révolution de la Terre autour du Soleil, d’une durée d’environ 365,25 jours, et est étroitement lié aux nécessités agricoles et climatiques. Les Égyptiens de l’Antiquité, par exemple, utilisaient un calendrier solaire pour prévoir les crues du Nil, événement crucial pour leur survie. Ce système fut perfectionné par les Grecs et les Romains, culminant avec la réforme julienne en 45 av. J.-C., qui introduisit une année de 365 jours avec une journée intercalaire tous les quatre ans. Ce calendrier solaire, adapté aux saisons et à la stabilité cosmique, s’est imposé comme une référence universelle dans les sociétés modernes, où il structure les calendriers civils et économiques.
Dans le Coran, la structuration divine du temps est soulignée à travers les cycles naturels. Ainsi, le verset : “Le nombre de mois auprès d’Allah est de douze mois, dans la prescription d’Allah, le jour où Il créa les cieux et la terre.” (Sourate At-Tawba, 9:36) affirme une organisation temporelle immuable, tandis que le verset : “C’est Lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et Il en a déterminé les phases afin que vous connaissiez le nombre des années et le calcul (du temps).” (Sourate Yunus, 10:5) illustre la complémentarité des luminaires célestes dans la mesure du temps. Ces références coraniques transcendent les distinctions entre les calendriers, en mettant l’accent sur le rôle des cycles naturels comme signes de la sagesse divine.
Les calendriers lunaire et solaire reflètent deux conceptions complémentaires du temps : l’une marquée par la cyclicité et le renouvellement constant des phases lunaires, l’autre par la régularité et la stabilité des saisons solaires. Tandis que le calendrier lunaire, associé à la spiritualité, invite à une introspection et à un rythme harmonisé avec les phénomènes célestes, le calendrier solaire, lié aux réalités terrestres, organise les activités humaines autour des saisons et de l’ordre agricole. Ensemble, ils traduisent une quête universelle d’équilibre entre l’éphémère et le permanent, entre le terrestre et le cosmique, entre l’humain et le divin.
Dans la perspective soufie, l’instant éternel (al-ān al-dā’im) ne se réduit pas à une succession d’instants comme le conçoit la temporalité humaine. Il représente une réalité transcendante qui dépasse les cadres limités du temps et de l’espace. Ce concept sublime exprime une station spirituelle où le cheminant perçoit l’éternité dans le présent : une Présence divine continue qui unifie harmonieusement le passé, le présent et le futur.
Ainsi, le temps ordinaire, marqué par sa linéarité et sa contingence, n’est qu’une illusion propre à la dimension matérielle et phénoménale. Par contraste, l’instant éternel incarne une vérité intemporelle, un lieu spirituel où la Création demeure en équilibre par la constance et la perfection de la Présence divine (Hadrat al-Haqq).
C’est tout le sens de cette maxime que lance Cheikh Ibrahim Niasse (RTA) à Mouhamadoul Amine Al Jakani :
« Le temps n’existe que dans la sphère illusoire de l’existence contingente. L’instant éternel, en revanche, représente une Présence divine continue, transcendant les limites du temps et de l’espace, et incarnant la permanence absolue de l’Être suprême. »
Le temps, dans sa linéarité apparente, constitue une construction humaine destinée à baliser notre existence. Les divisions temporelles – années, mois, jours, heures – ne sont que des conventions visant à donner un sens à ce qui, en vérité, échappe à toute emprise. Ces jalons traduisent notre rapport à la finitude et à la contingence, tout en posant une question essentielle : qu’est-ce que le temps au-delà de ces repères ? Cette interrogation, loin d’être abstraite, touche à la nature de la temporalité et au rôle qu’elle joue dans notre quête de sens. Le paradoxe fondamental réside dans la coexistence de deux perceptions : un écoulement continu et une ouverture vers l’intemporel. Cette tension est magistralement illustrée dans l’histoire des Gens de la Caverne.
Relatée dans le Coran, cette histoire raconte le destin d’un groupe de jeunes hommes pieux qui, persécutés pour leur foi, trouvent refuge dans une caverne. Allah leur accorde une miséricorde particulière : un sommeil miraculeux qui dure «trois cents ans, plus neuf» (Sourate Al-Kahf, 18:25). Ce récit dépasse le cadre historique pour interroger notre compréhension du temps. En mentionnant leur sommeil en termes à la fois solaires et lunaires, le Coran souligne la relativité des systèmes humains de mesure du temps et nous invite à considérer une autre dimension, où passé, présent et futur se fondent dans une réalité unique. Le temps devient ainsi un miroir de l’éternité divine, un espace où l’homme, en quête de sens, peut transcender sa condition finie.
L’histoire des Gens de la Caverne est une allégorie intemporelle qui mêle profondeur spirituelle et réflexion philosophique. En fuyant leur société idolâtre, ces jeunes hommes témoignent d’une foi absolue en Allah et d’un courage exemplaire face à l’oppression. Leur refuge dans la caverne symbolise bien plus qu’un lieu physique : il incarne le sanctuaire intérieur où l’âme se retire pour se purifier et se connecter à sa source. Cette retraite évoque la khalwa (isolement spirituel), une étape essentielle pour s’éloigner des illusions du monde et pénétrer l’intimité divine. Leur sommeil, qui suspend le temps, peut être interprété comme une extinction spirituelle, un effacement de l’ego et des attachements matériels. Ce n’est qu’après cette immersion dans la sphère divine qu’ils se réveillent, purifiés et transformés, prêts à affronter une réalité renouvelée.
Le Coran, par ce miracle, nous rappelle que le temps humain est illusoire face à l’éternité divine. Allah, Maître du temps et de l’espace, surpasse les lois terrestres et nous invite à faire de chaque instant une porte vers l’intemporel. Cette perspective rejoint la réflexion de Saint Augustin dans Les Confessions, où il s’interroge sur la nature insaisissable du temps :
«Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; mais si l’on me pose la question et que je veuille l’expliquer, je ne le sais plus.» (Livre XI, chapitre 14)
Pour Saint Augustin, le temps est à la fois familier et mystérieux, insaisissable dans sa définition mais profondément ressenti dans l’expérience humaine. Le temps n’est pas une simple suite d’instants, mais un espace supra rationnel où l’homme, en sublimant la contingence, trouve une voie pour s’élever vers l’éternité.
Leur chien, accroupi à l’entrée de la caverne, ajoute une dimension singulière à cette histoire. Fidèle et protecteur, il incarne l’humilité et la vigilance nécessaires pour préserver le cœur des influences néfastes. Sa présence illustre que la miséricorde divine surpasse toute limite, embrassant avec bienveillance l’ensemble des créatures. Lorsqu’ils se réveillent, les jeunes hommes découvrent un monde changé, où le monothéisme a triomphé. Cette victoire spirituelle reflète l’idée que les transmutations intérieures du croyant finissent par influencer la société. La foi sincère détient une force transformatrice exceptionnelle : en s’accordant pleinement avec la volonté divine, l’homme incarne un modèle d’élévation et de vertu. Il inspire et guide ceux qui l’entourent, devenant un vecteur de paix, de sagesse et de réconfort pour ceux qui cherchent un chemin vers la vérité.
Le Coran, dans un verset puissant de la Sourate Al-Asr, résume la responsabilité de l’homme face au temps :
«Par le temps ! L’homme est certes, en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance.» (Sourate Al-Asr, 103:1-3)
Il appartient à l’Homme d’investir le temps de manière significative, en orientant ses actions vers l’éternel. L’homme véritable, le vicaire, agit comme un pont entre le temporel et le transcendant, remplissant sa temporalité d’actes qui résonnent dans l’éternité. Ainsi, chaque instant est une opportunité de se rapprocher du Divin, d’effacer les frontières illusoires entre l’humain et l’infini.
En définitive, l’histoire des Gens de la Caverne, tout en explorant la relativité du temps, invite à dépasser l’éphémère pour embrasser une vision sacrée de la temporalité. Elle enseigne que le temps, loin d’être un simple écoulement, est un espace sacré où s’exprime la liberté humaine et où se construit la relation entre l’homme et son Créateur. À travers ce récit, le Coran et les traditions spirituelles offrent une leçon universelle : transcender les apparences pour toucher l’éternité. Que cette réflexion illumine nos actions et nous rappelle, en chaque instant, la présence d’une réalité infinie.
Chaque instant, bien qu’éphémère, recèle une opportunité unique d’accéder à l’intemporel. Le temps, en tant que don divin, porte en lui des potentialités infinies, nous invitant à aligner nos actions avec l’ordre cosmique et à faire de chaque moment une offrande de dévotion et de transcendance.
Alors que débute cette nouvelle année, prenons le temps de méditer sur sa valeur profonde, non pas comme une simple mesure, mais comme un cadre privilégié où se façonne notre quête de sens. Que cette année soit un jalon précieux dans votre cheminement, un moment propice pour unir l’éphémère au sublime et inscrire vos vies dans l’éternité.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous, qu’elle soit empreinte de paix intérieure, de richesse spirituelle, et d’une harmonie profonde avec le temps et l’éternité.